
Light in August
Traduction et préface : Maurice-Edgar Coindreau
ISBN : 9782070366217
Extraits
Personnages
Une symphonie. Ou un fleuve. C'est à cela que l'on songe lorsque l'on arrive à la dernière page de "Lumière d'Août." On peut même dire que l'idée vous en vient dès que s'ouvre le coeur du livre : l'histoire de Christmas. Une symphonie au phrasé parfait, un fleuve au cours parfait : Faulkner maîtrise ici son art et oui, tout y est dans un équilibre parfait.
"Lumière d'Août" pourtant n'est pas un roman dont on vous parlera volontiers - à moins d'avoir affaire à un aficionado de Faulkner. Les grands et déstabilisants romans du début, comme "Le Bruit & la Fureur" ou encore "Sanctuaire", ont l'habitude de rafler la mise, avec leur parfum de scandale et cette espèce de chaos verbal et temporel que l'auteur s'est amusé à y semer. Avec une écriture dont la seule étrangeté réside dans le parler local utilisé pour les dialogues, et la ligne pure des trois mouvements de l'intrigue se succédant sans aucune de ces tricheries temporelles affectionnées par l'écrivain américain, "Lumière d'Août" a pratiquement tout ce qu'il faut pour être considéré comme le roman le plus classique de Faulkner, en tous cas dans sa forme. Parce que, pour les thèmes ...
Le passé du Sud, les fantômes de ces soldats gris et or qui foncent à toute allure sans se soucier beaucoup - à l'exception de généraux comme Johnston et Lee - de stratégie pratique, cet univers vaincu qui refuse de disparaître de la mémoire collective - ce thème majeur, l'un des premiers à pointer son nez dans les premières pages de "Sartoris", le Livre-Père, est ici confié aux bons soins du révérend Gail Hightower afin qu'il le défende, si nécessaire jusqu'à la mort. Et c'est ce que fera ce personnage étrange, mourant d'une attaque, les yeux ouverts sur une charge de cavaliers où il croit se voir, lui, bien vivant mais sous les traits de son grand-père. Le drame du révérend - celui qui conduit d'ailleurs à son bannissement de l'Eglise dans laquelle il fut ordonné - c'est son obsession pour la Guerre civile et sa certitude de ne faire qu'un avec le grand-père esclavagiste qui la vécut. Ce protestant bon teint préserve en lui un petit coin bien caché pour le principe de la réincarnation - pour sa réincarnation. Etait-il fou dès le début ? L'est-il devenu ? Ou ne ferait-il pas preuve, au contraire, d'une grande lucidité ?Quel est le but exact de cette quête qui lui fait sacrifier ses études, sa foi, son église, sa femme et sa vie d'homme à une espèce de mirage ? Le lecteur n'obtiendra pas la réponse mais c'est pour Faulkner une nouvelle manière de tenter d'exorciser la malédiction du Sud.
Ce que l'on peut désigner comme le "mouvement" Hightower se mêle étroitement au "mouvement" Lena Grove, sur lequel s'ouvre le roman. Lena est une jeune femme originaire de l'Alabama, qui a pris la route de Jefferson et donc du Mississippi afin de rejoindre un certain Lucas Burch, beau parleur qui lui a fait un enfant mais dont elle ne doute pas qu'il soit parti à la ville pour y trouver du travail et préparer leur avenir commun. Simple, gentille pas aussi naïve qu'on serait en droit de se l'imaginer, Lena est un personnage lumineux, apaisant, qui, une fois n'est pas coutume dans l'univers faulknerien, verra le Destin lui sourire.
A Jefferson en effet, où elle arrive un samedi après-midi, elle se rend droit à la scierie du coin, persuadée d'y trouver Lucas. En lieu et place, il n'y a que Byron Bunch, ouvrier modèle, l'un des rares Blancs à visiter encore Hightower, brave garçon paisible au coeur généreux qui, en la voyant, succombe au coup de foudre (le premier et le seul de son existence) et ne va plus la quitter. Mais quand il lui décrit les autres employés de la scierie - comme c'est samedi, il est seul à travailler - Lena comprend que son fameux Lucas y a travaillé sous un nom d'emprunt, celui de Joe Brown. Il faut en parler au passé car, depuis plusieurs mois, Burch-Brown s'est associé à un autre ancien employé de la scierie, un certain Joe Christmas. Les deux hommes vendraient de l'alcool trafiqué.
Et c'est ainsi que, après quelques notes timides mais entêtantes au tout début du livre, éclate dans toute sa puissance le "mouvement" central de "Lumière d'Août", celui consacré à Joe Christmas, homme que son teint basané et ses cheveux noirs font passer pour un étranger de souche italienne ou mexicaine mais qui sait, lui - ou croit savoir et il faut noter que le doute reste entier jusqu'à la fin du livre - qu'il a du sang noir dans les veines. Faulkner nous détaille l'essentiel de son existence d'orphelin songeur, adopté par une famille de paysans strictement religieux (son père adoptif est le puritain-type, qui voit une Jézabel dans chaque femme et ne parle de sexe qu'avec mépris et dégoût), puis vagabond qui choisit la marginalité parce qu'il est convaincu que "la goutte de trop" qu'il a dans les veines le condamne à ce genre de vie. Arrivé à Jefferson, Christmas y devient l'amant de la seule héritière de la famille Burden, vit avec elle une liaison passionnée et chaotique et finit par lui trancher la gorge avant de mettre le feu à la maison. Il s'enfuit alors et échappe quelque temps aux autorités jusqu'au moment où il choisit de se laisser capturer. Par une manoeuvre habile de Faulkner, et plutôt difficile à réaliser sans tomber dans l'incroyable ou le mélodramatique, son arrestation va lui permettre de retrouver ses grands-parents et de connaître les circonstances de sa naissance et de son abandon. Sous le choc, il parvient à s'échapper et tombe dans la même journée, les armes à la main, sous les balles d'un milicien de la garde locale qui le castre.
Le livre entier est porté par trois forces primaires que nous donnons ici dans un ordre qui n'est peut-être pas le bon - à chacun de choisir celui qu'il voudra : le sentiment religieux et l'éternel clivage sudiste du Blanc et du Noir, ce dernier se confondant cependant parfois avec la question religieuse puisque cette goutte de sang à la fois fatale et problématique, seule responsable du gâchis absolu que sont la vie et la mort de Christmas, est similaire à la malédiction biblique ancestrale subie, pour d'autres raisons, par Adam et Eve.
Il va de soi que Faulkner ne saurait présenter ces forces de manière simpliste. Ainsi, le sexe, la troisième de ces forces et une véritable jouissance pour Joanna Burden à une certaine époque de sa liaison avec Christmas, reste ambigu pour beaucoup de personnages. Christmas lui-même, avec l'éducation qu'il a reçue, méprise totalement les femmes et certains des affrontements qu'il a, enfant et adolescent, avec son père adoptif, ne sont pas sans révéler chez ce dernier une tendance à l'homosexualité qui réapparaît, effleurée plus qu'affirmée, dans les rapports de Christmas adulte avec celui qui le dénoncera, "Joe Brown" (on admirera l'ironie du nom usurpé), alias Lucas Burch. Mais le sentiment religieux est sans doute celui qui s'en tire le plus mal dans l'affaire puisque Faulkner démontre qu'il sert trop souvent de masque et de justification à l'asservissement de l'espèce féminine et, de façon générale, à celui des minorités.__
Que dire encore sur cette "Lumière d'Août" ? Peut-être que Joanna Burden est la petite-fille ou l'arrière-petite-fille de l'un des deux Nordistes que le colonel Sartoris abattit lors de la Reconstruction. Surtout, que ce roman de Faulkner est l'un de ses meilleurs livres, qu'il faut se garder de mépriser au prétexte qu'il n'a pas bénéficié de la même publicité que ses aînés. Et plus encore que sa lecture conforte dans la certitude qu'on gagne beaucoup à lire l'oeuvre de l'écrivain américain dans son ordre de parution. 



 C'est pour ainsi dire la règle. Règle à laquelle Oates déroge sans vergogne en faisant paradoxalement de son méchant de la seconde partie une lavette déplorable et maniérée dont on a bien de peine à croire que certains de ses disciples - enfin, l'un d'entre eux au moins - puissent l'appeler "Maître."
C'est pour ainsi dire la règle. Règle à laquelle Oates déroge sans vergogne en faisant paradoxalement de son méchant de la seconde partie une lavette déplorable et maniérée dont on a bien de peine à croire que certains de ses disciples - enfin, l'un d'entre eux au moins - puissent l'appeler "Maître." Dans ce cas, rien à dire : c'est un chef-d'oeuvre.
Dans ce cas, rien à dire : c'est un chef-d'oeuvre. 
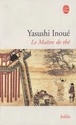

 tant sont grands le génie de son auteur et la générosité avec laquelle il accueille son lecteur dès lors que celui-ci accepte de plonger sans filet.
tant sont grands le génie de son auteur et la générosité avec laquelle il accueille son lecteur dès lors que celui-ci accepte de plonger sans filet.


 ) Parmi les Dolls, deux grands noms du punk, Johnny Thunders et Jerry Nolan, qui, rongés par les drogues - l'héroïne surtout - et par l'alcool, mourront l'un et l'autre la même année, en 1975 - après la séparation des Dolls, Thunders avait fondé les Heartbreakers.
) Parmi les Dolls, deux grands noms du punk, Johnny Thunders et Jerry Nolan, qui, rongés par les drogues - l'héroïne surtout - et par l'alcool, mourront l'un et l'autre la même année, en 1975 - après la séparation des Dolls, Thunders avait fondé les Heartbreakers.
 Quoi qu'il en soit, armez-vous de patience pour appréhender ce livre, n'hésitez pas à relire certains passages - voire à les lire à haute voix - et surtout, faites attention aux moindres détails : Heimito von Doderer sait très bien où il va même si vous, vous vous sentez en droit d'en douter.
Quoi qu'il en soit, armez-vous de patience pour appréhender ce livre, n'hésitez pas à relire certains passages - voire à les lire à haute voix - et surtout, faites attention aux moindres détails : Heimito von Doderer sait très bien où il va même si vous, vous vous sentez en droit d'en douter. 


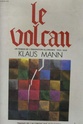



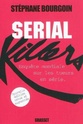













Derniers commentaires