
Kindheitmuster
Traduction : Ghislain Riccardi
Postface : Danièle Sallenave
Extraits
Personnages
Voici l'un des ouvrages les plus complexes que j'aie jamais lus. Non en raison de son style, qui demeure, en dépit de la traduction de l'allemand, largement accessible au lecteur moyen, mais en raison de ses thèmes principaux : la mémoire individuelle face à l'Histoire d'une part et, de l'autre, le choix de l'intervention chez l'être humain confronté à la dictature et enfin, bien sûr, la culpabilité. ("Trame d'Enfance" est même si complexe qu'il nécessitera certainement, à un moment ou à un autre, une relecture.)
Ce livre éveille chez son lecteur une profonde fascination. Fascination pour l'intelligence de celle qui écrit mais aussi fascination pour l'impossibilité dans laquelle Christa Wolf s'est trouvée, en dépit (ou à cause de) son intelligence, d'éviter la chape de plomb de la culpabilité qui s'est abattue sur l'Allemagne de l'après-guerre.
Avec ce sûr instinct de l'écrivain qui entend exprimer ce qu'il ressent avec un maximum d'intégrité, Wolf souligne - consciemment ou non, il est difficile de l'affirmer sans se tromper - cette contradiction en utilisant tour à tour les trois premières personnes du singulier pour évoquer son propre personnage. L'enfant qu'elle fut, celle qui vécut sous le nazisme puisqu'elle avait eu la malchance de naître en 1929 et dans une petite ville proche de la frontière germano-polonaise, elle l'habille d'une nouvelle identité et la baptise d'un nouveau prénom : Nelly. Et quand elle raconte Nelly, ses parents qui, comme tant d'Allemands, préféraient ne rien voir parce qu'ils ne pouvaient pas faire grand chose, et le cours de leur existence trop paisible si l'on considère les malheurs qui s'abattaient à l'époque sur tant de malheureux, Wolf préfère utiliser le "elle" : c'est la seule façon qu'elle a trouvée, nous explique-t-elle, pour avoir un recul acceptable.
Lorsqu'elle parle de son incarnation actuelle, c'est-à-dire la Christa Wolf écrivain, l'un des plus connus de la République démocratique allemande, elle n'a par contre aucune difficulté à utiliser le "Je". Mais le plus troublant - et ce que certains lecteurs jugeront déstabilisant - c'est le "Tu" qu'elle emploie pour s'adresser au fantôme de sa jeunesse et, de temps à autre, au "Je-Christa Wolf", ce qui lui arrive par exemple quand elle analyse son travail d'écrivain sur le présent manuscrit.
La forme de "Trame d'Enfance" n'est donc pas simple et risque d'occasionner quelques maux de tête à certains. 
Le fond, maintenant : Christa Wolf, citoyenne de R. D. A. probablement revenue de certains aspects parmi les plus rebutants du communisme stalinien mais plaçant encore tous ses espoirs dans les théories socialistes, met en parallèle un voyage qu'elle fit dans les années soixante-dix, en compagnie de son mari et de leur fille, dans sa ville natale entretemps redevenue polonaise (Landsberg-an-der-Warthe, actuelle Gorzów Wielkopolski), et les souvenirs qu'elle a conservés de sa jeunesse sous les aigles nazies. La question centrale est, on le devine : pourquoi ?
Vu le contexte, ce serait une question banale si Wolf ne s'interrogeait en fait non seulement sur les motifs qui ont permis au national-socialisme de prendre son envol mais aussi - mais surtout et l'on est tenté d'écrire hélas ! - sur les raisons qui l'ont empêchée, elle ou plutôt Nelly, petite fille, puis adolescente et toute jeune fille, de s'opposer au régime totalitaire.
Le lecteur en reste ébranlé. Il aimerait pouvoir saisir l'écrivain par les épaules, la secouer et lui dire : "Mais vous n'étiez qu'une enfant ! "
Qu'est-ce qu'un enfant pouvait comprendre au monde des adultes ? Pour un enfant, si intelligent soit-il, les adultes détiennent la Vérité et l'enfant accepte leurs conclusions sans broncher : il se soumet - il ne peut rien faire d'autre. Et pour ce qui est de l'adolescence, bien sûr, bien sûr, Nelly-Christa aurait pu se révolter. A cela près que, de manière assez paradoxale, l'adolescence, c'est aussi la période de sa vie où l'on veut être le plus en phase avec les gens de son âge. Or, dans l'univers de l'époque, tous les jeunes appartenaient aux "Jeunesses Hitlériennes" et l'endoctrinement était puissant - tout-à-fait comme il l'était chez les Soviétiques, soit-dit en passant. Sophie Scholl elle-même appartenait au mouvement. Ce qui faisait la différence, c'était la solide éducation religieuse reçue par Scholl, éducation dont l'humanisme lui permit de réfléchir et de passer à l'acte, et bien entendu sa maturité : elle était de huit ans plus âgée que Nelly-Christa.
De ce "soutien passif" au régime national-socialiste, Christa Wolf ne s'est visiblement jamais remise. Cette femme, dont nul ne niera ni la profondeur de pensée ni les facultés de réflexion, a conservé, envers cette "faute", ce "péché" évidemment capital, le même sentiment ambivalent et trouble, fait de nausées et de jouissances, qui préside à la destinée de ceux qui aiment à se savoir coupables. Pas forcément coupables de quelque chose de déterminé d'ailleurs : rien que coupables.
Doit-on y voir la conséquence d'une enfance durant laquelle Nelly accompagna ses parents très régulièrement à l'église ? (Aller régulièrement à la messe ou au culte n'est pas toujours garant d'une bonne compréhension des valeurs premières du christianisme. Bien souvent, cela garantit même le contraire ...  ) Ou du discours, culpabilisateur à outrances, qui, après la Défaite allemande, succéda à l'embrigadement hitlérien - discours qui, rappelons-le, est malheureusement toujours de rigueur pour trop de gens de nos jours ? Le passage sous la férule communiste de la République démocratique allemande, aux ordres de Staline et de l'URSS, y a-t-il tenu un rôle ? Y a-t-il un quelconque rapport avec cet incomparable esprit de discipline et de groupe qui reste l'une des caractéristiques du peuple allemand ?
) Ou du discours, culpabilisateur à outrances, qui, après la Défaite allemande, succéda à l'embrigadement hitlérien - discours qui, rappelons-le, est malheureusement toujours de rigueur pour trop de gens de nos jours ? Le passage sous la férule communiste de la République démocratique allemande, aux ordres de Staline et de l'URSS, y a-t-il tenu un rôle ? Y a-t-il un quelconque rapport avec cet incomparable esprit de discipline et de groupe qui reste l'une des caractéristiques du peuple allemand ?
Toujours est-il que "Trame d'Enfance" est LE roman de la Culpabilité allemande post-hitlérienne. Une culpabilité qui s'exerce essentiellement, et c'est en cela qu'elle est doublement inique, envers des innocents. Une culpabilité obtenue au prix d'une sorte d'effarant "lavage de cerveaux" qui n'aurait retenu que l'adage de l'Ancien Testament sur la malédiction du prétendu Eternel se déchaînant sur sept fois sept générations. Une culpabilité enfoncée dans le coeur et le cerveau pour paralyser, déprécier, humilier et faire souffrir au maximum en particulier ceux "qui n'y étaient pas." Une culpabilité contre laquelle Christa Wolf, convaincue pour on ne sait quelle raison du bien-fondé du châtiment, n'a pas cherché à se défendre.
Pour cette femme sensible et particulièrement intelligente, ce dut être un martyre. Mais toute médaille à son revers. Et cela nous permet, à nous, ses lecteurs, de réaliser combien cette manière de déclarer le peuple allemand, dans sa totalitéet, attention ! dans sa totalité passée, présente et à venir, coupable du nazisme revient à le charger d'une malédiction à vie - une malédiction à laquelle, comme visait à le dire Martin Walser|fr]dans le discours si controversé qu'il prononça à Francfort le 11 octobre 1998, il serait grand temps de mettre un terme.
Quoi qu'il en soit, lisez "Trame d'Enfance" et penchez-vous sur le reste de l'oeuvre de Christa Wolf : vous ne devriez pas le regretter. 







 - vous estimez encore que Robert Boulin s'est suicidé, contactez un chirurgien du cerveau. Sinon, déchirez votre carte d'électeur : la sinistre déliquescence dans laquelle n'arrête pas d'agoniser notre Vème République s'enracine pour beaucoup dans cette triste affaire, précédée trois ans plus tôt par l'Affaire De Broglie et à laquelle l'Affaire Bérégovoy fera écho près de quatorze ans plus tard. Au pays des politicards, l'intégrité est bien LA valeur à abattre.
- vous estimez encore que Robert Boulin s'est suicidé, contactez un chirurgien du cerveau. Sinon, déchirez votre carte d'électeur : la sinistre déliquescence dans laquelle n'arrête pas d'agoniser notre Vème République s'enracine pour beaucoup dans cette triste affaire, précédée trois ans plus tôt par l'Affaire De Broglie et à laquelle l'Affaire Bérégovoy fera écho près de quatorze ans plus tard. Au pays des politicards, l'intégrité est bien LA valeur à abattre. 
 Mais cela reste de bonne guerre.
Mais cela reste de bonne guerre.

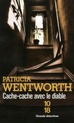




 - plutôt du côté féminin. Mais avec l'âge, on évolue et on se dit - surtout quand on a sur son forum un dénommé "Ignatius"
- plutôt du côté féminin. Mais avec l'âge, on évolue et on se dit - surtout quand on a sur son forum un dénommé "Ignatius" 
 Ou si sa recherche frénétique du mot juste ne relevait pas d'un désir profond d'éradiquer en lui les velléités flamboyantes et baroques qui font la grandeur et la faiblesse de "Salammbô."
Ou si sa recherche frénétique du mot juste ne relevait pas d'un désir profond d'éradiquer en lui les velléités flamboyantes et baroques qui font la grandeur et la faiblesse de "Salammbô."
















