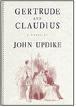Hudson River Traduction : Claude Seban
Joyce Carol Oates fait partie de ces auteurs prolifiques qui imaginent des intrigues fouillées et des personnages à l'avenant. D'un tempérament de fresquiste, elle ne semble jamais à court pour faire sortir de son cerveau des protagonistes qui, bien que présentant des points communs puisqu'ils naviguent tous dans le vaste océan de la société américaine, se révèlent toujours aussi différents que pourraient l'être leurs empreintes génétiques. En ce sens, on peut voir en Oates un écrivain populaire, comme Balzac, Hugo, Zola le furent en leur temps et son oeuvre restera certainement comme l'une des plus importantes dans la littérature étatsunienne et mondiale du XXème siècle.
Même s'il n'appartient pas pour moi aux ouvrages majeurs, "Hudson River" ne contrevient pas à ces règles générales. La romancière y utilise une mort accidentelle - celle d'Adam Berendt, sculpteur atypique qui avait choisi de s'installer dans la banlieue chic de la ville de Salthill, Hudson River - comme un levier destiné à peser sur la vie des principaux amis et relations d'Adam et à y créer une brèche par laquelle, avec les interrogations, va s'introduire le désir de plus en plus impérieux de se remettre en question.
Ce sont surtout les femmes qui se sentent concernées par la disparition d'Adam. Des femmes qui, presque toutes, avaient rêvé de devenir sa maîtresse mais qui n'avaient jamais été pour lui que des amies. Dans leur ombre, leurs conjoints qui, eux aussi, vont être gagnés par la volonté d'une existence différente. Tout ce qu'ils découvrent ne pas savoir sur leur ami disparu les poussent toutes et tous à revoir leur mode d'existence, à le rêver plus conforme ... A quoi ? A ce qu'Adam aurait voulu pour eux, pensent certain(e)s. A ce qu'Adam avait réussi à faire de sa propre existence, estiment les autres.
En filigrane, pour les plus fidèles - et, en ce domaine, ce sera Augusta Cutler qui se révèlera la plus digne - la quête du véritable Adam Berendt.
Peut-être certains trouveront-ils assez pénibles les premières pages du livre. Tel fut mon cas, je l'avoue sans honte. Puis j'ai compris que ces hachures geignardes et ces phrases tronçonnées, soulignant le battement affolé des pensées de celle qui, la première, apprend la mort d'Adam, Marina Troy, la libraire du coin, pour laquelle il avait fait beaucoup et qui, comme les autres, rêvait de l'avoir pour amant, servent aussi à fixer le caractère du personnage avant qu'il ne parte à la recherche de lui-même.
Quoi qu'il en soit, "Hudson River" est un roman honorable, construit aussi solidement qu'à l'accoutumée et idéal pour des vacances tranquilles mais il n'est en rien comparable à ces très grandes pointures que sont, chez Oates, "Nous étions les Mulvaney", "Blonde" ou encore "Délicieuses pourritures." Qu'on se le dise et on n'encourra aucune déception. ;o)